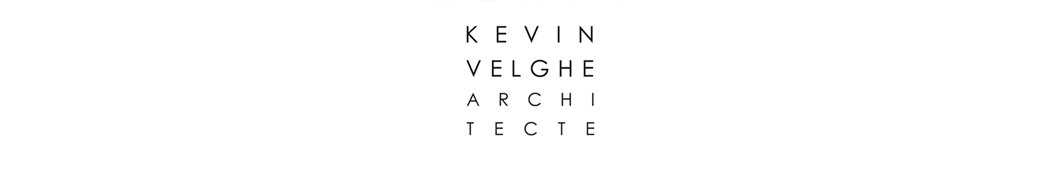Habiter les territoires insulaires
Réflexion sur la valorisation de l’existant à Belle-Île-en-Mer
Belle-Île, surnommée la bien nommée en raison du cadre de vie qu’elle offre, est devenue une destination touristique majeure depuis le début des années 90. On recense jusqu’à 400 000 visiteurs par saison pour seulement 5 000 habitants à l’année. Cela contribue à renforcer la croissance économique de l’île mais également les potentialités de construction. Afin de limiter l’expansion, plusieurs strates de protection se sont mises en place comme la loi littorale qui participe à la préservation de la bande littorale de l’île, ou encore la loi ALUR qui a pour objectif de lutter contre l’étalement urbain.
L’expansion Urbaine
Historiquement, l’expansion à Belle-Île s’est organisée autour d’un principe simple : les longères s’implantaient les unes après les autres, en alignement, chaque nouvelle construction venant s’adosser à un pignon existant. Cette logique a permis de former de petits hameaux compacts de quelques maisons, créant des ensembles cohérents et marquant durablement l’identité architecturale belliloise.
D’une expansion diffuse …
Au fil du temps, cette logique d’alignement s’est diluée. L’expansion s’est faite de manière plus dispersée, portée par des choix individuels et la disponibilité du foncier. De nouvelles constructions se sont éloignées des hameaux d’origine, dessinant des extensions en couronne, en périphérie ou sous forme de lotissements parfois déconnectés du tissu existant. Ces implantations ont contribué à fragmenter le paysage et à accroître la consommation d’espace.

Expansion en couronne

Expansion en périphérie

Expansion en lotissement
… À une expansion raisonée
Face à ces dynamiques, il devient essentiel d’accompagner l’évolution de Belle-Île vers un développement plus maîtrisé afin de limiter l’étalement et le mitage. Cela implique de renforcer les hameaux en comblant les vides et en prolongeant les constructions existantes, tout en privilégiant des extensions raisonnées plutôt qu’un étalement non coordonné.